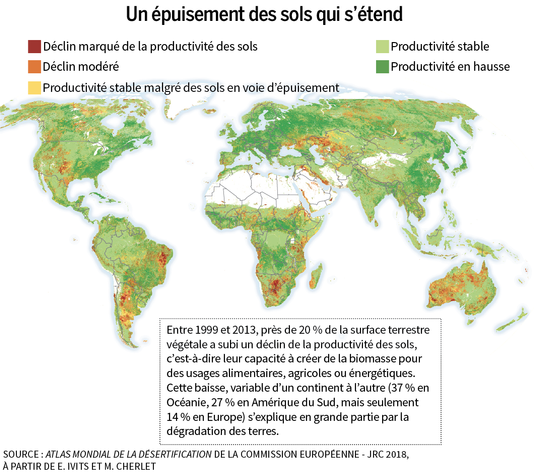Les dégâts environnementaux infligés par l’homme sont irréversibles, alertent Gerald Markowitz et David Rosner, deux historiens des sciences américains. Gerald Markowitz (John Jay College of Criminal Justice) et David Rosner (université Columbia à New York), historiens des sciences, ont consacré toute leur carrière à l’étude des pollutions industrielles, notamment le plomb et les polychlorobiphényles. En janvier, les deux Américains ont mis en ligne des milliers de documents internes de firmes (« Toxic Docs ») qui dévoilent les stratégies des industriels pour dissimuler ces crimes environnementaux. Ils lancent une mise en garde sur les conséquences tragiques de notre usage de la planète dans cette tribune publiée par Le Monde le 1er septembre 2018. Lire aussi « Vers une planète sans pollution » : les Nations Unies proposent 50 mesures urgentes, La pollution, responsable de 9 millions de morts dans le monde par an et Les océans pollués par des particules invisibles de plastique.
Le canal qui se jette dans la rivière Buriganga, à Dacca, au Bangladesh, un amoncellement de déchets qui empêchent l’eau de couler. Photo Gaël Turine
La planète est un endroit remarquablement résilient. Au fil des siècles, l’homme en a détruit les forêts naturelles, brûlé les sols et pollué les eaux pour finalement constater que, dans l’ensemble, la planète s’en remettait. Longtemps, les villes se débarrassaient de leurs déchets dans les rivières, tandis que les premières usines construites le long de leurs rives disposaient de ces cours d’eau comme de leurs propres égouts ; autrefois sans vie, ces rivières peuvent retrouver une vie foisonnante pour peu qu’on leur en laisse le temps.
Ceux d’entre nous qui ont atteint un certain âge et ont grandi à New York se souviennent sans doute des bancs de poissons morts qui venaient s’échouer sur les rives de notre fleuve Hudson, zone morte il y a peu encore, et aujourd’hui si belle. Les forêts, rasées pour laisser place à des champs, reviendront vite une fois l’homme parti. Il suffit de se promener dans les bois verdoyants de la Nouvelle-Angleterre et d’imaginer, comme le poète Robert Frost, être les premiers à s’émerveiller de leur beauté pour tomber aussitôt sur des ruines des murets de pierre qui clôturaient autrefois les pâturages.
C’est alors seulement que nous en prenons conscience : ces arbres sont encore jeunes, et, il n’y a pas si longtemps, l’homme dénudait ces terres pour y développer pâturages et cultures. Nous nous sommes consolés en pensant que l’on pouvait gommer les atteintes que nous infligeons à l’environnement et que la nature pouvait guérir, à condition de la laisser en paix et de mettre fin à nos comportements destructeurs.
Mais une nouvelle réalité ébranle les fondements de notre droit de polluer à volonté en croyant que la nature finira par triompher. Et de plus en plus, cette réalité met au défi ce réconfort sur lequel nous nous étions reposés. Au cours du XXe siècle, nous avons non seulement modifié la surface de la Terre pour satisfaire notre dessein, mais nous l’avons fait de manière irréversible, au point qu’elle pourrait menacer notre existence même. Nous avons créé des environnements toxiques en faisant usage de technologies inédites et de matériaux de synthèse que la planète n’avait jamais connus.
Au début du XXe siècle, des usines gigantesques employant des dizaines de milliers d’ouvriers ont remplacé la fabrication à domicile et les artisans qualifiés pour devenir les lieux de production de nos vêtements, de nos chaussures et d’une myriade d’objets de consommation. La quasi-totalité des objets de notre quotidien provient de ces usines, depuis les plaques de plâtre jusqu’aux revêtements de toit et de sol en passant par nos ordinateurs ou nos environnements de travail. Dans notre cadre de vie, il n’y a rien, ou presque, qui ne sorte pas d’une usine.
Nous savons depuis longtemps que nombre de ces matériaux sont toxiques et peuvent détruire des vies. Si la nature peut se régénérer, certaines de ces substances toxiques tuent des travailleurs qui, eux, ne peuvent pas reprendre leurs vies : dans l’industrie, les ouvriers sont frappés depuis plus de deux siècles par ce fléau qu’est l’empoisonnement au plomb contenu dans les pigments des peintures ; on sait depuis le début du XXe siècle que le mercure tue les travailleurs ; et la poussière de charbon est identifiée comme cause de cancer du scrotum depuis l’époque de William Blake [artiste britannique de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle].
Mais les matériaux que nous fabriquons en usine n’ont plus rien à voir avec les produits naturels dont ils sont dérivés. Ils sont à l’origine de maladies nouvelles et de dangers auparavant inconnus. Ce sont les ouvriers qui, pour l’essentiel, ont payé le prix de la découverte de ces maladies : angiosarcome du foie causé par l’exposition au chlorure de vinyle monomère, élément constitutif des plastiques PVC ; mésothéliome causé par l’inhalation de poussière d’amiante ; leucémies causées par l’exposition au benzène et à d’autres hydrocarbures aromatiques.
Nous avons toujours sacrifié les travailleurs, victimes d’accidents industriels et de produits chimiques toxiques, mais aujourd’hui nous sommes peut-être confrontés au sacrifice de l’ensemble de la population. Plastiques et produits chimiques : des produits de synthèse que ni l’être humain ni la planète n’avaient côtoyés avant le XXe siècle sont maintenant déversés en permanence sur nos sols, dans les océans et dans l’air. Ces polluants provoquent des maladies, anéantissent les espèces et mettent l’environnement en danger.
A Anniston (Alabama), en mai. Monsanto Road longe l’usine et la décharge à ciel ouvert dans laquelle la firme américaine a déversé des milliers de tonnes de produits toxiques. Photo Samuel Bollendorff.
Dans les années 1980, les scientifiques ont identifié les impacts environnementaux majeurs de cette cupidité : pluies acides menaçant nos forêts, trous de la couche d’ozone laissant les rayonnements dangereux atteindre la surface de la Terre. Nous avons permis aux industriels de faire usage de notre monde comme de leur décharge privée et la source de leurs profits au point de menacer l’existence même de la vie telle que nous la connaissons. Des espèces disparaissent à un rythme inédit ; les températures moyennes augmentent sur toute la planète, entraînant guerres, famines et migrations de masse.
Nous avons accepté que les ouvriers et le reste de la population soient les principales victimes de cette cupidité, mais nous risquons désormais d’accepter que des régions entières deviennent inhabitables. Tchernobyl (Ukraine) et Fukushima (Japon) sont sans doute les cas les plus connus. Mais le péril, en Europe et aux Etats-Unis, n’est plus un secret : Anniston (Alabama), Dzerjinsk (Russie), les océans et d’autres endroits à travers le monde sont pratiquement devenus des zones mortes où les produits industriels ont endommagé l’environnement de manière irrémédiable.
Alors que nous observons les effets du réchauffement climatique submerger les nations, de nouvelles questions, d’ordre plus existentiel, surgissent aujourd’hui. Nous produisons des matériaux « contre nature » pour l’être humain et la planète ; leurs conséquences sont irréversibles et rendent la vie impossible pour des millions de personnes. Nous sommes en train d’engendrer un monde dystopique où seuls les puissants et les riches seront en mesure de survivre, cloîtrés derrière les murs de leurs enclaves privilégiées. La planète est certes résiliente : elle continuera de tourner sur son axe et d’accueillir la vie. Mais que cette vie prenne la forme d’êtres humains, rien n’est moins sûr.
(Traduit de l’anglais par Gilles Berton)
commenter cet article …